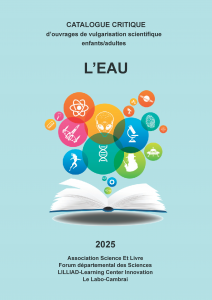L’eau, une ressource vitale, une menace létale, un besoin égal.
Depuis que la vie s’est répandue partout sur la planète Terre, tous les êtres vivants consomment l’eau en découvrant par expérience qu’elle est en même temps une ressource vitale, une menace létale, mais qu’elle représente un besoin égal pour tous. Dès lors que les humains ont pris conscience que leurs capacités les conduisaient à prendre l’ascendant sur les autres espèces, ils se sont inventés une perspective temporelle pour admirer leur apparente supériorité. Toutefois, les progrès réalisés dans la compréhension des processus vitaux les plus élémentaires montrent l’importance qu’y joue l’eau à toutes échelles (de la cellule à la planète), et devraient nous conduire à plus d’humilité.
Science et Livre a choisi le thème de l’eau. Certains diront que c’est un effet de mode ; la pression médiatique, permanente, étouffante, le suggère. Toutefois, c’est réellement une urgence. Le réchauffement climatique que nos activités humaines contribuent à emballer provoque des variations météorologiques très aléatoires à nos latitudes. Sécheresses, tornades, orages violents, canicules se succèdent d’une façon qui amènent les gens à douter de la notion de saison. En replaçant ces évènements en perspective planétaire sur le temps long, astronomes, climatologues et géologues apportent des éléments d’explication, justes, dont l’inconvénient est de ne pas répondre à la plupart des attentes immédiates et locales des populations qui subissent tantôt la rareté, tantôt l’excès d’eau.
Le catalogue qui suit n’est pas exhaustif ; il ne peut pas l’être, tant le sujet a déjà fait couler beaucoup… d’encre ! Il est nécessairement le résultat d’un choix, difficile le plus souvent. L’intention est de s’adresser aux jeunes générations. Et de le faire en restant accessible, par la lecture directe, par le langage intermédiaire d’un animateur, d’un enseignant, qui peut accompagner l’écrit et le dessin.
Un défi, qui concerne toutes les générations, est d’expliciter les mécanismes naturels en jeu en évitant de mobiliser les réactions de peur irrationnelle, recette trop fréquente parce que commercialement rentable. C’est un éveil à la maîtrise de soi. Le lecteur est invité à observer d’abord, à s’émerveiller de l’ingéniosité pour recueillir l’eau, la consommer, la rejeter avec les déchets qu’on lui confie. Prendre conscience qu’à toutes les échelles d’observation, l’eau est un agent mobile qui participe aux échanges entre les composants des organismes traversés. Au niveau cellulaire, elle apporte des éléments chimiques venus de l’extérieur et en évacue d’autres qui seraient néfastes à la cellule s’ils s’accumulaient. Il en est de même au niveau d’un organe dans un système complexe, ou d’un individu dans une population. Pour la consommation d’eau, il n’y a pas de différence entre un épi de blé dans un champ et un loup dans sa meute .exceptés les moyens mobilisés pour son absorption.
Les castors et l’espèce humaine construisent des barrages ; ça fait partie de leur stratégie vitale. Les aléas de l’évolution ont conduit la seconde à développer des aptitudes plus performantes que les premiers. La capacité d’observation et d’innovation permanente qui en résulte devrait être utilisée par l’espèce humaine pour améliorer sa connaissance du comportement des castors, dont l’expérience s’est affinée en quelques millions d’années. Ceux-ci ont répondu à leurs besoins sans détruire leur environnement. La dérive qu’affiche l’espèce humaine depuis une petite centaine d’années vers le gigantisme des réservoirs d’eau à construire en prévision de sécheresses à venir ne prend pas le même chemin !
G. de Marsily rappelle (L’eau, un trésor en partage, Dunod, 2009) que la planète Terre fonctionne depuis 4,6 milliards d’années avec une quantité qui paraît constante. La séismicité du globe, la tectonique des plaques ne seraient pas possibles sans eau circulant dans et entre les composants (cristaux, graviers, blocs rocheux). Le volcanisme en projette dans la stratosphère, tandis que des comètes et météorites nous en apportent. Le vrai problème est l’inégalité de répartition sur la surface du globe.
Dès lors que les premières cellules vivantes sont apparues (environ 4,3 milliards d’années), elles ont utilisé l’eau pour développer leur métabolisme. Une des conséquences a été la libération d’un composé gazeux alors considéré comme un poison : l’oxygène (vers 2,4 milliards d’années). Tous les organismes vivants qui se différencient peu à peu, vivent alors dans l’eau. Les pluies de l’époque ont apporté molécules et particules, dont des cellules vivantes, qui ont ruisselé sur les terres émergées. En retrouver les traces est l’obsession de chercheurs. C’est surtout entre 500 et 400 millions d’années que l’on identifie des structures végétales et même animales qui, piégées par les variations du niveau marin, se sont accrochées sur ces terres et ont dû apprendre à y survivre. Dès lors des sols peuvent commencer à se former aux dépens de roches qui, jusque-là, ne faisaient que se fragmenter en fonction des alternances gel/dégel locales. L’eau devient un agent chimique actif qui contribue à dégrader les roches et donc à libérer les éléments nutritifs dont la végétation a besoin. L’évolution est « rapide » puisque moins de 200 millions d’années plus tard se forme une première ceinture subéquatoriale de forêts qui envahissent les bordures de masses continentales convergeant alors l’une vers l’autre : c’est la forêt houillère du Carbonifère. Elle a stocké l’énergie solaire de l’époque que nous exploitons en brûlant le charbon.
Aujourd’hui, nous comprenons qu’aucun paysage n’est immuable, qu’en surface l’étendue de l’eau varie constamment et qu’elle contournera tous les obstacles que nous tenterons de lui imposer. Nous comprenons qu’elle s’immisce partout, entre et dans les grains minéraux, pénètre toutes les cellules vivantes. En transitant, elle facilite les transferts d’éléments chimiques, ceux qui se sont formés naturellement comme ceux que nous avons inventés et qu’elle n’a pas encore eu le temps d’apprendre à dégrader. Elle agit directement comme solvant, ou indirectement en véhiculant divers agents à fonction enzymatique
C’est l’eau qui nous domestique, et non l’inverse !
Francis MEILLIEZ
Professeur honoraire à l’Université de Lille
Directeur de la Société Géologique du Nord